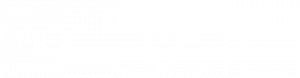Quand mon vieux camarade Antoine Rousseau du Kremlin-Bicêtre m’avait écrit, à la sortie du numéro 1, pour nous complimenter sur la revue et nous proposer un dialogue sur les aveugles à la Fondation Sainte-Marie, j’ai d’abord cru que sa boîte mail avait été piratée. Nous recevions alors essentiellement des lettres d’insultes suite à un éditorial désabusé, ironisant sur le décalage entre la longueur de nos études et les nouveaux centres de santé-champignons à 100 patients par jour qui poussent partout dans les villes et les campagnes (étions-nous des médecins ou des numéros ? « J’ai été opéré par le #23 mais le #66 est définitivement le plus empathique : notre consultation a duré presque une minute. » pourraient dire les patients sortant de ces usines nouvelles). Mais comme d’habitude, je me trompais ; Rousseau était un humaniste. « L’ophtalmologue et la cécité » était un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, et l’idée d’un entretien avec le directeur de la plus grande fondation de France consacrée aux aveugles l’occupait depuis longtemps.
Quelques semaines plus tard je lui téléphonai, pour le remercier de sa proposition et m’excuser d’avoir anticipé sa nomination de Professeur dans l’ours (savez-vous ce qu’est un ours ? Il s’agit de la colonne de gauche du sommaire où figurent les noms de l’équipe rédactionnelle et des contributeurs. C’est aussi un gros animal chevauché à l’occasion par Vladimir Poutine). « Il faut faire attention, m’avait-il expliqué, c’est le genre de choses qui peuvent énerver les universitaires », mais pour moi, tous mes amis brillants et pédagogues sont des professeurs. Comme le professeur Sarah Mrejen, qui a gentiment accepté de nous expliquer l’optogénétique et de nous rendre accessible la dernière expérience de l’équipe d’Alain-José Sahel publiée dans la revue Nature Medicine en mai 2021.
Grâce à sa proposition d’interview, une autre idée avait germé. Après tout, pourquoi ne pas consacrer l’ensemble du numéro 3 de Mon Œil ! aux aveugles ? C’est vrai, c’est la hantise de tout ophtalmologue : rendre son patient aveugle ou assister, impuissant, à la dégradation irrémédiable de sa vision. Et on ne s’y intéresse pas souvent de la perspective du malade.
Ce numéro a été monté en une nuit. Du crépuscule à l’aube, comme dirait Robert Rodriguez, mais sans quitter mon bureau, ce #3 réunit successivement un philosophe, un homme de loi, un agrégé de lettres, un photographe célèbre, la plus adorable des ophtalmologues-chercheuses-pianistes, et le président de la plus grande fondation de rééducation visuelle française, le tout dans un numéro entièrement dédié aux aveugles. J’aurais bien mis la couverture en braille aussi, mais cela a été refusé par l’équipe comptable qui m’a expliqué combien coûtait la commande d’un gaufrage sur papier pelliculé ; nous avons encore si peu d’abonnés… (smiley clin d’œil).
Que signifient les figures non-voyantes de la mythologie grecque ? Comment ressentir les choses quand on a perdu la vue à 33 ans ? Si les virus sont si impopulaires depuis qu’ils nous maintiennent en famille pour des durées infinies, saviez-vous qu’ils peuvent aussi induire la production de protéines sensibles à la lumière quand ils sont injectés dans les cellules ganglionnaires de la rétine d’un sujet malvoyant ? De qui parlait Diderot dans sa lettre sur les aveugles ? Pourquoi la justice est-elle aveugle à Washington et à Sarajevo, mais pas à Paris ni à Singapour ? etc. Mais tout cela reste ouvert à la discussion, et toujours très contestable. Après tout, c’est un journal scientifique ! Comme disait Woody Allen, « j’ai des questions à toutes vos réponses ».